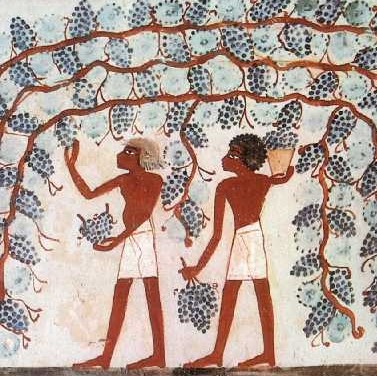Des enfants mis en pièces dans des orgies, des mères dévorant leur progéniture, un dieu du vin abreuvé de sang: l’image a traversé les siècles. On l’attribue à Dionysos (Bacchus pour les Romains), le plus insaisissable des dieux.
Mais derrière le récit sensationnel, les traces historiques sont minces: des sources rares, souvent tardives –de Plutarque à Tite-Live–, et une longue chaîne d’interprétations.
Au cours des quatre dernières décennies, chercheuses et chercheurs ont peu à peu disséqué cette rumeur antique : celle d’un culte où l’on aurait mangé des enfants.
Un mythe d’horreur et de renaissance
Tout part d’un mythe, celui du démembrement de Dionysos enfant par les Titans. Le récit, transmis dans la tradition orphique (notamment les Rhapsodies orphiques et repris par les Néoplatoniciens[1]), raconte comment le jeune dieu est capturé, découpé, bouilli et rôti, puis mangé avant de renaître. Zeus, pour le venger, foudroie les Titans, et de leurs cendres naît l’humanité, mêlée de chair divine et de poussière criminelle.
De là viendrait, croit-on, l’origine d’un culte sanglant.
Mais pour Maria Daraki, auteure de L’enfant dionysiaque (1981), il s’agit d’une allégorie cosmique: la mort du dieu n’est qu’une étape du cycle de la vie.
«Le dieu reçoit en sacrifice sa propre forme enfantine», écrit-elle, soulignant que la destruction et la renaissance se répondent comme deux moments d’un même mouvement. Dans cette vision, le «ragoût d’enfant» n’a rien d’un crime: c’est la métaphore d’une régénération du monde.
Une violence symbolique
Dans Le sacrifice humain en Grèce ancienne (1994), le bien nommé Pierre Bonnechere rappelle qu’aucun texte ne prouve l’existence d’un tel rituel. Les mots grecs σπαραγμός (sparagmós, «déchirement»)[2] et ὠμοφαγία (ōmophagía, «fait de manger cru»)[3] relèvent du langage religieux, non du compte rendu ethnographique. Ces mots expriment la perte de contrôle face au sacré, pas une pratique réelle.
Le sacrifice dionysiaque, à ses yeux, est un miroir de la cité grecque: un récit de la violence maîtrisée, où l’on transforme le sang en symbole.
Les mères coupables
Mais ce ne sont pas les dieux qu’on accuse: ce sont les femmes.
L’image des mères bacchantes –Agavè à Thèbes, les Minyades d’Orchomène, ou encore les Proitides d’Argos– a largement nourri la légende. Dans ces récits tragiques, des femmes de haut rang, frappées de délire dionysiaque, quittent leurs foyers, couronnées de lierre et armées du thyrse, pour rejoindre la montagne. Là, dans l’ivresse du dieu, elles croient célébrer des mystères sacrés; mais l’extase tourne à l’horreur: croyant déchirer un faon consacré à Dionysos, elles mettent en pièces leur propre enfant.
Ainsi Agavè, sœur de Sémélé, déchire son fils Penthée dans Les Bacchantes d’Euripide[4], croyant abattre un lion. Les Minyades, filles du roi Minyas, refusent de participer au culte; pour les punir, Dionysos leur inspire une folie vengeresse : elles tuent et mettent en lambeaux leurs enfants, avant d’être métamorphosées en chauves-souris[5].
Stéphanie Wyler, dans son étude Des ragoûts d’enfants dans les orgies dionysiaques? (2012), montre que ces histoires appartiennent au discours moral de la cité: elles servent à dénoncer les cultes féminins et à opposer un sacrifice «masculin et réglé» à la violence «sauvage» des femmes.
Daraki, de son côté, y voit l’expression d’une énergie refoulée: le pouvoir féminin, capable de donner la vie comme de la reprendre, ramené à la folie pour mieux être neutralisé. Le meurtre rituel de l’enfant devient ainsi le symbole d’un désordre domestiqué.
Salamine et le «sacrifice humain»
Certains auteurs antiques ont voulu donner corps à cette violence mythique. Plutarque raconte ainsi qu’avant la bataille de Salamine, Thémistocle aurait sacrifié trois jeunes Perses à Dionysos Omestès («mangeur-de-chair-crue»)[6]. Mais comme le rappelle Pierre Bonnechere, cette scène écrite six siècles après les faits relève de la légende politique, non du rituel. Stéphanie Wyler souligne d’ailleurs que les victimes étaient des ennemis adultes, non des enfants, et qu’aucun lien n’existe avec les cultes dionysiaques.
Le dieu et sa victime
Des mères égarées par la transe aux prêtres accusés de crimes, tout ramène à une même logique : celle d’un dieu qui efface les limites. Le culte de Dionysos brouille volontiers les frontières.
Dans plusieurs traditions, le dieu reçoit des victimes animales qui lui ressemblent: un chevreau pour Dionysos Eriphios («le chevreau»), un veau pour Dionysos Bougenès («né du Taureau»). À Ténédos, rapporte Élien[7], une vache enceinte est traitée comme une femme en couches avant que son veau ne soit sacrifié au dieu appelé anthrôporraistès («démembreur d’humains»).
Pour Daraki, cette fusion entre dieu et offrande traduit une vérité religieuse: chaque sacrifice répète symboliquement la mort et la renaissance du dieu.
Bonnechere y voit un compromis: la cité canalise la violence dionysiaque en la transposant dans le monde animal. La cruauté subsiste, mais sous une forme domestiquée.
Rome, la peur et le scandale
Quand le culte arrive à Rome, la peur change de visage.
Les Bacchanales, interdites en 186 avant notre ère, sont décrites par Tite-Live comme des assemblées mixtes où se retrouvent des hommes et des femmes de toutes conditions, y compris des jeunes. L’historien peint une scène de débauche nocturne:
«La violence demeurait cachée, car, sous les hurlements, le vacarme des tambourins et des cymbales, aucune voix de ceux qui criaient au secours au milieu des viols et des meurtres ne pouvait être entendue.»[8]
Quelques lignes plus loin, il ajoute encore, comme pour achever d’effrayer son lecteur:
«Ceux qui se montraient moins patients du déshonneur ou moins disposés au crime étaient immolés à la place des victimes.»[9]
Ce double registre –orgie et sacrifice– suffit à transformer un culte populaire en menace pour la cité.
Wyler souligne que ces accusations de crimes et d’orgies n’étaient qu’un prétexte politique: elles permettaient de justifier la répression sénatoriale et la reprise en main des cultes non contrôlés.
Dans sa thèse Eating People Is Might (2022), Christopher Weimer lit ce glissement comme un discours de pouvoir. Dionysos devient une figure de la domination: on le craint non pour ses festins, mais pour sa force. Le cannibalisme n’est plus un acte: c’est une métaphore du pouvoir dévorant. Rome invente un dieu anthropophage pour mieux s’en distinguer.
Une légende, pas un crime
Des «ragoûts d’enfants» dionysiaques, il ne reste que des mots: des mythes, des peurs et des images. Aucune source antique ne décrit un sacrifice d’enfant réel. Ce qu’on a longtemps pris pour des témoignages n’est qu’un discours symbolique sur la violence, le genre et le pouvoir.
Chez Daraki, le mythe traduit la circulation du vivant; chez Bonnechere, la maîtrise du désordre; chez Wyler, la fabrication d’une légende; chez Weimer, la récupération politique d’un imaginaire anthropophage.
Loin d’un culte sanguinaire, Dionysos apparaît comme un dieu du mélange -celui des formes, des êtres et des frontières.
Le véritable scandale n’est pas qu’on ait mangé des enfants en son honneur, mais qu’on ait osé penser une divinité capable d’engloutir toutes les oppositions: vie et mort, homme et bête, victime et dieu.
Sources
- M. Daraki, L’enfant dionysiaque, Raison Présente, n° 59, 1981.
- P. Bonnechère, Le sacrifice humain en Grèce ancienne, Liège, PULG, 1994.
- S. Wyler, Des ragoûts d’enfants dans les orgies dionysiaques?, in Mythes sacrificiels et ragoûts d’enfants, Paris, Les Belles Lettres, 2012.
- C. Weimer, Eating People Is Might: Power and the Representation of Anthropophagy in Antiquity, City University of New York, 2022.
[1] Rhapsodies orphiques, fr. 209–213; Proclus, In Timaeum 293c.
[2] Euripide, Bacchantes 1138–1141.
[3] Hymnes orphiques 44, 6.
[4] Euripide, Bacchantes 1114–1139.
[5] Ovide, Métamorphoses 4, 1–168 ; Antoninus Liberalis 10.
[6] Plutarque, Vie de Thémistocle 13, 2–3.
[7] Élien, Histoires variées 12, 34.
[8] Liv., 39, 8, 8: Occulebat vim quod prae ululatibus tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla vox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri poterat.
[9] Liv., 39, 13, 11: Si qui minus patientes dedecoris sint ac pigriores ad facinus, pro victimis immolari.
D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum